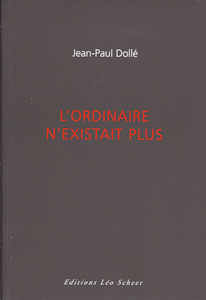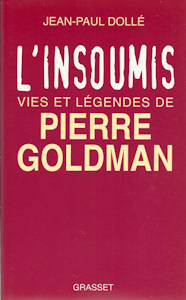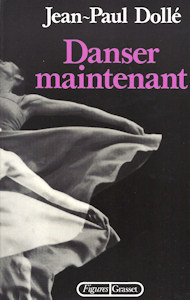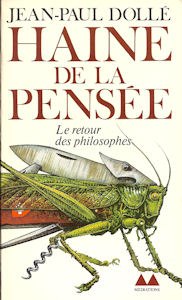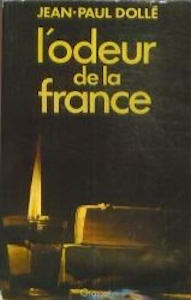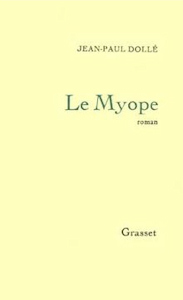" Il n'est pas du tout sûr qu'il existe du social, une espèce de terre meuble placée là de toute éternité, que les citoyens n'auraient qu'à labourer. Les sociologues, les pédagogues, les réformateurs devraient aller de temps à autre dans les hôpitaux psychiatriques. Ils se rendraient compte qu'ils peuvent eux aussi devenir schizophrènes, se couper de la réalité parce qu'elle fait trop mal; qu'ils peuvent eux aussi choisir de devenir mutiques parce que la parole tue, préférer la débilité parce qu'elle permet de se réfugier dans un asile, dès lors que les universités et les églises ne sont plus des abris contre la violence de l'Histoire."
"En fait, ce qu'il faut admettre en démocratie, c'est qu'il n'y a pas d'absolu, pas de vérité révélée, pas de certitude inébranlable, de futur garanti, de finalité claire, de but exclusif et de préceptes univoques.
Cette conception démocratique du monde intègre l'incertain, l'aléatoire, le fragmentaire, le disparate, l'errance et l'aventure. C'est le roman, comme l'a très bien montré Milan Kundera. Le roman, fait-il remarquer, est un genre littéraire inventé en Europe par Cervantes, quand il lance son don Quichotte contre les moulins, au nom d'un autre monde que le monde de la réalité. Dans le roman, il n'y a pas de solution, de savoir définitif, de recettes pour conduire sa vie. Tout est équivoque, les êtres humains, les situations, les sentiments, les perceptions, les sensations, les connaissances. Le roman n'a pas de fin, car rien n'est jamais fini; personne ne trouve le Graal ou la pierre philosophale, tout est bâti sur du sable, sur de la fiction. Le roman est une éthique de la connaissance qui se donne pour but de transcrire le plus honnêtement possible l'être, dans toutes ses richesses, ses contradictions, sa perpétuelle gestation. Le roman exclut le dogmatisme, le fanatisme, la terreur et le pouvoir absolu. C'est pourquoi tous les pouvoirs absolus veulent le tuer."
"Il est des jours plombés, des mois pluvieux où tout se ressemble et suscite la lancinante experience de l'agonie molle, la haine de soi et des autres et où la fatigue fait gonfler vos varices et vous rend impuissant. Il y a des jours, des mois, quelquefois des années, où l'insipide de la survie, les notes à payer, le travail à bâcler, la vue du sang, du feu et l'immense étalage de la bêtise à la Une des journaux découragent.
Il y a des tas de jours, de mois, d'années où le temps ne signifie rien. Le temps passe, il ne repasse pas. Tout simplement, la vie se retranche.
Ah oui, Monsieur le Président, il faut être héroïque pour garder en soi la petite lueur, la misérable espérance, l'insistante exigence, l'endurant désir de démocratie. Rester démocrate... la grande solitude du coureur de fond!"


















![]()



![]()