HARTMUT ROSA
Rendre le monde indisponible
"Voici mon hypothèse de travail : dans la mesure où nous, membres de la modernité tardive, visons, sur tous les plans cités – individuel, culturel, institutionnel et structurel –, la mise à disposition du monde, le monde nous fait toujours face sous forme de « point d’agression », ou de série de points d’agression, c’est-à-dire d’objets qu’il s’agit de connaître, d’atteindre, de conquérir, de dominer ou d’utiliser, et c’est précisément en cela que la « vie », ce qui constitue l’expérience de la vitalité et de la rencontre – ce qui permet la résonance –, que la « vie », donc, semble se dérober à nous, ce qui, à son tour, débouche sur la peur, la frustration, la colère et même le désespoir, qui s’expriment ensuite entre autres dans un comportement politique impuissant fondé sur l’agression."
"Pour résumer l’argument que j’aimerais développer ici, ma thèse est que ce programme de mise à disposition du monde, imposé institutionnellement et fonctionnant, culturellement, comme une promesse, non seulement ne « fonctionne » pas, mais bascule littéralement en son contraire. Le monde rendu disponible sur les plans scientifique et technique, économique et politique semble se dérober et se fermer à nous d’une manière mystérieuse ; il se retire, devient illisible et muet, et plus encore : il se révèle à la fois menacé et menaçant, et donc au bout du compte constitutivement indisponible. Le symptôme manifeste de cette évolution est que, dans la culture de la modernité tardive, le « monde » apparaît de manière prédominante comme environnement ou comme le « global » de la globalisation politico-économique. Ce qui domine, dans le premier aspect, c’est alors la perception de la « destruction de l’environnement », dont les conséquences nous menacent de plus en plus. Mais les choses ne paraissent pas différentes quant au second aspect : la globalisation signale aujourd’hui, dans le discours politique, la perception d’un extérieur chaotique, périlleux, incontrôlable, qui exerce une pression dangereuse sur l’espace délimité de notre univers familier et contre lequel protectionnistes et militaristes promettent de nous préserver à l’aide de murs et de clôtures, de barrières douanières, mais aussi de dispositifs de télésurveillance et de tir automatique. Le monde devient ainsi à la fois ce qui subit une menace inquiétante et ce qui menace de manière inquiétante – or cela est précisément le contraire du disponible ; le monde apparaît comme indisponible. "
![]()
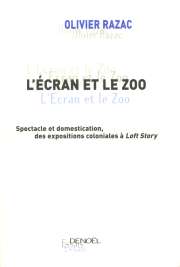
![]()
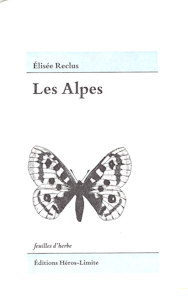
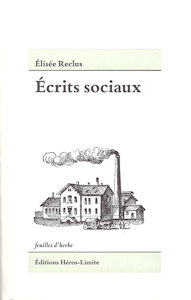
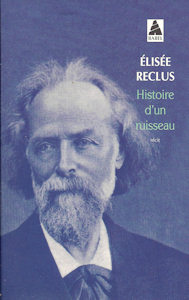
![]()
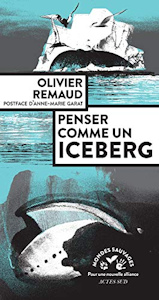
![]()
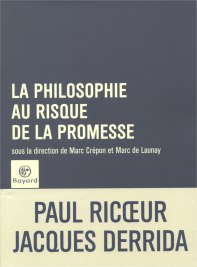
![]()
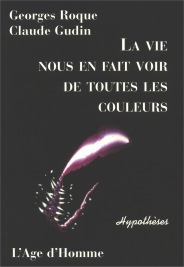
![]()
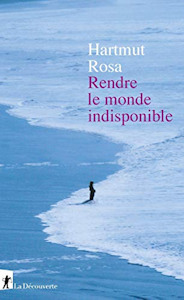
![]()
![]()
![]()
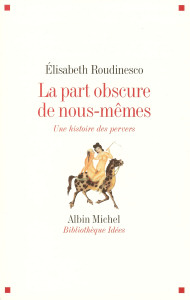
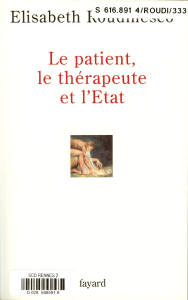
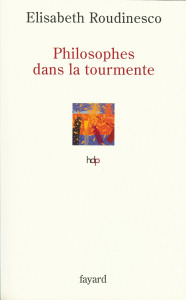
![]()
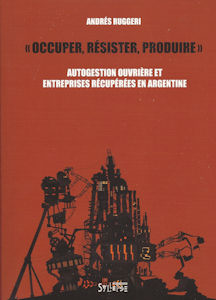
![]()